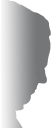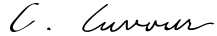Cavour, Camillo Benso di a Savoia, Vittorio Emanuele II di 1858-07-24 #3684
- Mittente:
- Cavour, Camillo Benso di.
- Destinatario:
- Savoia, Vittorio Emanuele II di.
- Data:
- 24 Luglio 1858.
Baden, 24 juillet 1858
Sire,
La lettre chiffrée que j'ai expédiée à V. M. de Plombières n'a pu donner à V. M. qu'une idée fort incomplète des longues conversations que j'ai eues avec l'Empereur. Je pense qu'Elle sera par conséquent impatiente d'en recevoir une relation exacte et détaillée. C'est ce que ie m'empresse de faire, à peine avoir quitté la France, par cette lettre que j'expédierai à V. M. par Mr Tosi, attaché à la Légation de Berne.
L'Empereur, dès que je fus introduit dans son cabinet, aborda la question, cause de mon voyage. Il débuta en disant qu'il était décidé à appuyer la Sardaigne de toutes ses forces dans une guerre contre l'Autriche, pourvu que la guerre fût entreprise pour une cause non révolutionnaire, qui pût être justifiée aux yeux de la diplomatie et plus encore de l'opinion publique en France et en Europe.
La recherche de cette cause présentant la principale difficulté à résoudre pour se mettre d'accord, j'ai cru devoir traiter cette questjon avant toutes les autres. J'ai proposé d'abord de faire valoir les griefs auxquels donne lieu la peu fidèle exécution de la part de l'Autriche de son traité de commerce avec nous. À cela l'Empereur a repondu: qu'une question commerciale de médiocre importance ne pouvait donner lieu à une grande guerre destinée à changer la carte de l'Europe. Je proposai alors de mettre en avant de nouveau les causes qui nous avaient déterminés au Congrès de Paris à protester contre l'extension illégitime de la puissance de l'Autriche en Italie; c'est-à-dire le traité de 47 entre l'Autriche et les Ducs de Parme et de Modène, l'occupation prolongée de la Romagne et des Légations, les nouvelles fortifications élevées autour de Plaisance.
L'Empereur n'agréa pas cette proposition. Il observa que puisque les griefs que nous avions faits valoir en 1856 n'avaient pas été jugés suffisants pour amener l'intervention de la France et de l'Angleterre en notre faveur, on ne comprendrait pas comment maintenant ils pourraient justifier un appel aux armes. «D'ailleurs -a-t-il ajouté - tant que mes troupes sont à Rome, je ne puis guère exiger que l'Autriche retire les siennes d'Ancône et de Bologne». L'objection était juste. Il fallut donc renoncer à ma seconde proposition; je le fis à regret, car elle avait quelque chose de franc et d'audacieux, qui allait parfaitement au caractère noble et généreux de V. M. et du peuple qu'Elle gouverne.
Ma position devenait embarrassante, car je n'avais plus rien de bien défini à proposer. L'Empereur vint à mon aide et nous nous mîmes ensemble à parcourir tous les Etats de l'Italie, pour y chercher cette cause de guerre si difficile à trouver. Après avoir voyagé dans toute la péninsule sans succès, nous arrivâmes, presque sans nous en douter, à Massa et Carrara, et là nous découvrîmes ce que nous cherchions avec tant d'ardeur. Ayant fait à l'Empereur une description exacte de ce malheureux pays, dont il avait d'ailleurs déjà une idée assez précise, nous convîmes que l'on provoquerait une adresse des habitants à V. M. pour demander sa protection et réclamer même l'annexion de ces Duchés à la Sardaigne. V. M. n'accepterait pas la dédition proposée, mais prenant fait et cause pour ces populations opprimées, adresserait au Duc de Modène une note hautaine et menaçante. Le Duc, fort de l'appui de l'Autriche, y répondrait d'une manière impertinente. Là dessus V. M. ferait occuper Massa et la guerre commencerait.
Comme ce serait le Duc de Modène qui en serait la cause, l'Empereur pense qu'elle serait populaire non seulement en France mais également en Angleterre et dans le reste de l'Europe, vu que ce Prince est, à tort ou à raison, considéré comme le bouc émissaire du despotisme. D'ailleurs le Duc de Modène n'ayant reconnu aucun des souverains qui ont régné en France depuis 1830, l'Empereur a moins de ménagements à garder envers lui qu'envers tout autre Prince.
Cette première question résolue, l'Empereur me dit: «Avant d'aller plus loin, il faut songer à deux graves difficultés que nous rencontrerons en Italie: le Pape et le Roi de Naples. Je dois les ménager: le premier pour ne pas soulever contre moi les catholiques en France, le second pour nous conserver les sympathies de la Russie, qui met une espèce de point d'honneur à protéger le roi Ferdinand.
Je répondis à l'Empereur que, quant au Pape, il lui était facile de lui conserver la tranquille possession de Rome au moyen de la garnison française qui s'y trouvait établie, quitte à laisser les Romagnes s'insurger; que le Pape n'ayant pas voulu suivre à leur égard les conseils qu'il lui avait donnés, il ne pouvait trouver mauvais que ces contrées profitassent de la première occasion favorable pour se délivrer d'un détestable système de gouvernement que la Cour de Rome s'était obstinée à ne pas réformer; que, quant au Roi de Naples, il ne fallait pas s'occuper de lui, à moins qu'il ne voulût prendre fait et cause pour l'Autriche; quitte toutefois à laisser faire ses sujets, si, profitant du moment, ils se débarrassaient de sa domination paternelle.
Cette réponse satisfit l'Empereur, et nous passâmes à la grande question: Quel serait le but de la guerre?
L'Empereur admit sans difficulté qu'il fallait chasser tout à fait les Autrichiens de l'Italie, et ne pas leur laisser un pouce de terrain en deçà des Alpes et de l'Isonzo. Mais ensuite, comment organiser l'Italie? Après de longues dissertations, dont j'épargne le récit à V. M., nous aurions à peu près convenu des bases suivantes, tout en reconnaissant qu'elles étaient susceptibles d'être modifiées par les événements de la guerre. La vallée du Pô, la Romagne et les Légations auraient constitué le Royaume de la Haute Italie sur lequel régnerait la maison de Savoie. On conserverait au Pape, Rome et le territoire qui l'entoure. Le reste des États du Pape avec la Toscane formerait le Royaume de l'Italie centrale. On ne toucherait pas à la circonscription territoriale du Royaume de Naples. Les quatre États italiens formeraient une confédération à l'instar de la Confédération germanique, dont on donnerait la Présidence au Pape pour le consoler de la perte de la meilleure partie de ses États.
Cet arrangement me paraît tout à fait acceptable. Car V. M. en étant Souverain de droit de la moitié la plus riche et la plus forte de l'Italie, serait souverain de fait de toute la péninsule.
Quant au choix des souverains à placer à Florence et à Naples dans le cas fort probable où l'oncle de V. M. et son cousin prissent le sage parti de se retirer en Autriche, la question a été laissée en suspens; toutefois l'Empereur n'a pas caché qu'il verrait avec plaisir Murât remonter sur le trône de son père; et de mon côté j'ai indiqué la Duchesse de Parme comme pouvant occuper, du moins d'une manière transitoire, le palais Pitti. Cette dernière idée a plu infiniment à l'Empereur, qui paraît attacher un grand prix à ne pas être accusé de persécuter la Duchesse de Parme, en sa qualité de princesse de la famille de Bourbon.
Après avoir réglé le sort futur de l'Italie, l'Empereur me demanda ce qu'aurait la France et si V. M. céderait la Savoie et le comté de Nice. Je répondis que V. M. professant le principe des nationalités, comprenait qu'il s'en suivait que la Savoie dût être réunie à la France; que par conséquent elle était prête à en faire le sacrifice quoiqu'il lui en coûtât excessivement à renoncer à un pays, qui avait été le berceau de sa famille, et à un peuple qui avait donné à ses ancêtres tant de preuves d'affection et de dévouement. Que quant à Nice, la question était différente, car les Niçards tenaient par leur origine, leur langue et leurs habitudes plus au Piémont qu'à la France, et que par conséquent leur accession à l'Empire serait contraire à ce même principe qu'on allait prendre les armes pour faire triompher. Là dessus l'Empereur caressa à plusieurs reprises sa moustache et se contenta d'ajouter que c'étaient là pour lui des questions tout à fait secondaires, dont on aurait le temps de s'occuper plus tard.
Passant ensuite à examiner les moyens à employer pour que la guerre eût une issue heureuse, l'Empereur observa qu'il fallait tâcher d'isoler l'Autriche et de n'avoir à faire qu'avec elle; que c'était pour cela qu'il tenait tant à ce qu'elle fût motivée par une cause qui n'effrayât pas les autres puissances du continent et qui fût populaire en Angleterre. L'Empereur a paru convaincu que celle que nous avions adoptée remplissait ce double but. L'Empereur compte positivement sur la neutralité de l'Angleterre; il m'a recommandé de faire tous nos efforts pour agir sur l'opinion publique dans ce pays pour forcer son gouvernement, qui en est l'esclave, à ne rien entreprendre en faveur de l'Autriche. Il compte également sur l'antipathie du Prince de Prusse envers les Autrichiens, pour que la Prusse ne se prononce pas contre nous. Quant à la Russie, il a la promesse formelle et plusieurs fois répétée de l'empereur Alexandre de ne pas contrarier ses projets sur l'Italie. Si l'Empereur ne se fait pas illusion, ainsi que je suis assez porté à le croire d'après tout ce qu'il m'a dit, la question serait réduite à une guerre entre la France et nous d'un côté, et l'Autriche de l'autre.
L'Empereur toutefois considère que la question, même réduite à ces proportions, n'en a pas moins une extrême importance et ne présente encore d'immenses difficultés. L'Autriche, il ne faut pas se le dissimuler, a d'énormes ressources militaires. Les guerres de l'Empire l'ont bien prouvé. Napoléon a eu beau la battre pendant quinze ans en Italie et en Allemagne, il a eu beau détruire un grand nombre de ses armées, lui enlever des provinces et la soumettre à des taxes de guerre écrasantes; il l'a toujours retrouvée sur les champs de bataille prête à recommencer la lutte. Et l'on est forcé de reconnaître qu'à la fin des guerres de l'Empire, à la terrible bataille de Leipzig, ce sont encore les bataillons autrichiens qui ont le plus contribué à la défaite de l'armée française. Donc, pour forcer l'Autriche à renoncer à l'Italie, deux ou trois batailles gagnées dans les vallées du Pô et du Tagliamento ne seront pas suffisantes, il faudra nécessairement pénétrer dans le centre de l'Empire et l'épée sur le cœur, c'est-à-dire à Vienne même, la contraindre à signer la paix sur les bases arrêtées d'avance.
Pour atteindre ce but, des forces très considérables sont indispensables. L'Empereur les évalue à 300.000 hommes au moins, et je crois qu'il a raison. Avec 100.000 hommes on bloquerait les places fortes du Mincio et de l'Adige et l'on garderait les passages du Tyrol; 200.000 hommes marcheraient sur Vienne par la Carinthie et la Styrie. La France fournirait 200.000 hommes, la Sardaigne et les autres provinces d'Italie les autres 100.000. Le contingent italien paraîtra peut-être faible à V. M.; mais si Elle réfléchit qu'il s'agit des forces qu'il faut faire agir, des forces en ligne, elle reconnaîtra que pour avoir 100.000 hommes disponibles, il en faut 150.000 sous les armes.
L'Empereur m'a paru avoir des idées fort justes sur la manière de faire la guerre et sur le rôle que les deux pays devaient y jouer. Elle a reconnu que la France devait faire de la Spezia sa grande place d'armes et agir spécialement sur la droite du Pô, jusqu'à ce qu'on se fût rendu maître du cours de ce fleuve en forçant les Autrichiens à se renfermer dans les forteresses. Il y aurait donc deux grandes armées, dont une commandée par V. M. et l'autre par l'Empereur en personne.
D'accord sur la question militaire, nous l'avons été également sur la question financière, qui, je dois le faire connaître à V. M., est celle qui préoccupe spécialement l'Empereur. Il consent toutefois à nous fournir le matériel de guerre dont nous pourrions avoir besoin, et à nous faciliter à Paris la négociation d'un emprunt. Quant au concours des provinces italiennes en argent et en nature, l'Empereur croit qu'il faut s'en prévaloir tout en les ménageant jusqu'à un certain point.
Les questions que je viens d'avoir l'honneur de résumer à V. M. aussi brièvement que possible furent l'objet d'une conversation avec l'Empereur qui dura de 11 heures du matin à 3 heures l'après midi. À trois heures l'Empereur me congédia en m'engageant à revenir à 4 heures pour aller avec lui faire une promenade en voiture.
À l'heure indiquée nous montâmes dans un élégant phaéton traîné par des chevaux américains que l'Empereur guidait lui-même, et suivi d'un seul domestique il me conduisit pendant trois heures au milieu des vallons et des forêts qui font des Vosges une des parties les plus pittoresques de la France.
 peine étions nous sortis des rues de Plombières, l'Empereur entama le sujet du mariage du prince Napoléon, en me demandant quelles étaient les intentions de V. M. à cet égard. Je répondis que Votre Majesté s'était trouvée dans une position fort embarrassante, lorsque je lui avais communiqué les ouvertures que Bixio m'avait faites, car Elle avait eu des doutes sur le prix que lui, l'Empereur, y attachait; que se rappelant certaine conversation que V. M. avait eue avec lui à Paris en 1855 au sujet du prince Napoléon et de ses projets de mariage avec la duchesse de Gênes, il ne savait trop à quoi s'en tenir. J'ajoutai que cette incertitude avait augmenté à la suite de l'entrevue de V. M. avec le docteur Conneau, qui, pressé de toute façon à ce sujet par Elle et par moi, avait déclaré n'avoir non seulement aucune instruction, mais encore ignorer complètement ce que l'Empereur pensait à cet égard. J'ajoutai que V. M., bien qu'attachant un prix immense à faire ce qui pourrait lui être agréable, avait une grande répugnance à marier sa fille à cause de son jeune âge, et ne saurait lui imposer un choix auquel elle répugnerait. Que, quant à V. M. si l'Empereur le désirait beaucoup, elle n'avait pas d'objections invincibles à faire au mariage, mais qu'elle voulait laisser une entière liberté à sa fille.
L'Empereur répondit qu'il désirait vivement le mariage de son cousin avec la princesse Clotilde; qu'une alliance avec la famille de Savoie serait de toutes celle qu'il préférerait; que s'il n'avait pas chargé Conneau d'en parler à V. M., c'est qu'il croyait de ne pas devoir faire des démarches auprès d'Elle, sans être certain d'avance qu'elles seraient agréées. Quant à la conversation avec V. M. que je lui avais rappelée, l'Empereur eut l'air d'abord de ne pas s'en souvenir, puis au bout de quelque temps il m'a dit: «Je me rappelle fort bien d'avoir dit au Roi que mon cousin avait eu tort de demander la main de la duchesse de Gênes, mais c'était parce que je trouvais fort inconvenant qu'il lui fît parler de mariage peu de mois après la mort de son mari.
L'Empereur revint à plusieurs reprises sur la question du mariage. Il dit en riant qu'il était possible qu'il eût dit quelquefois du mal de son cousin à V. M., car souvent il avait été en colère contre lui; mais qu'au fond il l'aimait tendrement parce qu'il avait d'excellentes qualités, et que depuis quelque temps il se conduisait de manière à se concilier l'estime et l'affection de la France. «Napoléon, - ajouta-t-il - vaut beaucoup mieux que sa réputation; il est frondeur, aime la contradiction, mais il a beaucoup d'esprit, pas mal de jugement, et un cœur très bon». Ceci est vrai; que Napoléon ait de l'esprit V. M. a pu en juger et je pourrais le certifier d'après les nombreuses conversations que j'ai eues avec lui. Qu'il ait du jugement, sa conduite depuis l'exposition qu'il a présidée, le prouve. Enfin que son cœur soit bon, la constance dont il a fait preuve, soit avec ses amis, soit envers ses maîtresses en est une preuve sans réplique. Un homme sans cœur n'aurait pas quitté Paris au milieu des plaisirs du carnaval pour aller faire une dernière visite à Rachel, qui se mourait a Cannes, et cela quoiqu'ils se fussent séparés quatre années plus tôt.
Dans mes réponses à l'Empereur je me suis toujours étudié à ne pas le blesser, tout en évitant de prendre un engagement quelconque. A la fin de la journée, au moment de nous séparer, l'Empereur me dit: «Je comprends que le Roi ait une répugnance à marier sa fille si jeune, aussi je n'insisterai point pour que le mariage ait lieu de suite; je serai tout disposé à attendre un an et plus s'il le faut. Tout ce que je désire c'est de savoir à quoi m'en tenir; veuillez en conséquence prier le Roi de consulter sa fille et de me faire connaître ses intentions d'une manière positive. S'il consent au mariage, qu'il en fixe l'époque; je ne demande d'autres engagements que notre parole réciproquement donnée et reçue». Là-dessus nous nous sommes quittés. L'Empereur en me serrant la main, me congédia en me disant: «Ayez confiance en moi, comme j'ai confiance en vous».
V. M. voit que j'ai suivi fidèlement ses instructions. L'Empereur n'ayant point fait du mariage de la princesse Clotilde une condition sine qua non de l'alliance, je n'ai pas pris à ce sujet le moindre engagement, ni contracté une obligation quelconque. Maintenant je prie V. M. de me permettre de lui exprimer d'une façon franche et précise mon opinion sur une question de laquelle peut dépendre le succès de la plus glorieuse entreprise, de l'œuvre la plus grande qui ait été tentée depuis bien des années.
L'Empereur n'a pas fait du mariage de la princesse Clotilde avec son cousin une condition sine qua non de l'alliance, mais il a clairement manifesté qu'il y tenait beaucoup. Si le mariage n'a pas lieu, si V. M. refuse sans raison plausible les propositions de l'Empereur, qu'arrivera-t-il? L'alliance serai-t-elle rompue? C'est possible, mais je ne pense pas que cela ait lieu. L'alliance se fera. Mais l'Empereur y apportera un esprit tout différent de celui qu'il y aurait apporté, si pour prix de la couronne d'Italie qu'il offre à V. M. Elle lui avait accordé la main de sa fille pour son plus proche parent. S'il est une qualité qui distingue l'Empereur, c'est la constance dans ses amitiés et dans ses antipathies. Il n'oublie jamais un service, comme il ne pardonne jamais une injure. Or le refus auquel il s'est exposé, serait une injure sanglante, il ne faut pas se le dissimuler. Ce refus aurait un autre inconvénient: il placerait dans les conseils de l'Empereur un ennemi implacable. Le prince Napoléon, plus Corse encore que son cousin, nous vouerait une haine mortelle et la position qu'il occupe, celle à laquelle il peut aspirer, l'affection, je dirai presque la faiblesse que l'Empereur a pour lui, lui donneront des moyens nombreux de la satisfaire.
Il ne faut pas se le dissimuler: en acceptant l'alliance qui lui est proposée, V. M. et sa nation se lient d'une manière indissoluble à l'Empereur et à la France. Si la guerre qui en sera la conséquence est heureuse, la dynastie de Napoléon est consolidée pour une ou deux générations; si elle est malheureuse, V. M. et sa famille courent d'aussi graves dangers que son puissant voisin. Mais ce qui est certain, c'est que le succès de la guerre, les conséquences glorieuses qui doivent en résulter pour V. M. et son peuple, dépendent en grande partie du bon vouloir de l'Empereur, de son amitié pour V. M. Si au contraire il renferme dans son cœur contr'Elle une véritable rancune, les conséquences les plus déplorables peuvent s'en suivre. Je n'hésite pas à déclarer avec la plus profonde conviction qu'accepter l'alliance et refuser le mariage serait une faute politique immense, qui pourrait attirer sur V. M. et notre pays de grands malheurs.
Mais, je le sais, V. M. est père autant que Roi; et c'est comme père qu'Elle hésite à consentir à un mariage, qui ne lui paraît pas convenable et n'être pas de nature à assurer le bonheur de sa fille.
Que V. M. me permette d'envisager cette question, non avec l'impassibilité du diplomate, mais avec l'affection profonde, le dévouement absolu que je lui ai voué.
Je ne pense pas qu'on puisse dire que le mariage de la princesse Clotilde avec le prince Napoléon soit inconvenant. Il n'est pas roi, il est vrai, mais il est le premier prince du sang du premier Empire du monde; il n'est séparé du trône que par un enfant de deux ans. D'ailleurs V. M. doit bien se résoudre à se contenter d'un Prince pour sa fille, puisqu'il n'y a pas en Europe de rois ni de princes héréditaires disponibles. Le prince Napoléon n'appartient pas à une ancienne famille souveraine, il est vrai; mais son père lui léguera le nom le plus glorieux des temps modernes; et par sa mère, princesse de Wurtemberg, il est allié aux plus illustres maisons princières de l'Europe. Le neveu du doyen des Rois, le cousin de l'Empereur de Russie, n'est pas tout à fait un parvenu auquel on ne puisse sans honte s'allier.
Mais les principales objections qu'on peut faire à ce mariage reposent peut-être sur le caractère personnel du Prince et sur la réputation qu'on lui a faite. A ce sujet je me permettrai de répéter ce que l'Empereur m'a dit avec une entière conviction, qu'il vaut mieux que sa réputation. Jeté tout jeune dans le tourbillon des révolutions, le Prince s'est laissé entraîner à des opinions fort exagérées. Ce fait, qui n'a rien d'extraordinaire, a excité contre lui une foule d'ennemis. Le Prince s'est fort modéré depuis; mais ce qui lui fait un grand honneur, c'est qu'il est resté fidèle aux principes libéraux de sa jeunesse, tout en renonçant à les appliquer d'une manière déraisonnable et dangereuse; c'est qu'il a conservé ses anciens amis bien qu'il eussent été frappés par la disgrâce. Sire, l'homme qui, en arrivant au faîte des honneurs et de la fortune, ne désavoue pas ceux qui furent ses compagnons d'infortune et ne désavoue pas les amitiés qu'il avait dans les rangs des vaincus, n'a pas mauvais cœur. Le Prince a bravé la colère de son cousin pour conserver ses anciennes affections; il ne lui a jamais cédé sur ce point, il ne cède pas davantage aujourd'hui. Les généreuses paroles qu'il a prononcées à la distribution des prix de l'exposition de Poitiers en est une preuve évidente. La conduite du Prince en Crimée est regrettable. Mais s'il n'a pas su résister aux ennuis et aux privations d'un long siège, il a pourtant montré à la bataille d'Alma du courage et du sang froid. D'ailleurs, il pourra réparer sur le champs de l'Italie le tort qu'il a pu faire sous les remparts de Sébastopol.
La conduite privée du Prince a pu être légère; mais elle n'a jamais donné lieu à de graves reproches. Il a toujours été bon fils, et avec son cousin, s'il l'a fait plus d'une fois enrager, dans les questions sérieuses il lui est toujours demeuré fidèle et attaché.
Malgré tout ce que je viens de dire, je comprends que V. M. hésite et craigne de compromettre l'avenir de sa fille bien aimée. Mais serait-elle plus tranquille en unissant son sort à un membre d'une vieille famille princière? L'histoire est là pour nous prouver que les princesses sont exposées à une bien triste existence lors même que leurs mariages ont lieu d'accord avec les convenances et les vieux usages. Pour prouver cette vérité, je n'irai pas chercher des exemples bien loin; je mettrai sous les yeux de V. M. ce qui s'est passé de ces jours dans le sein de sa propre famille.
L'oncle de V. M., le roi Victor-Emmanuel, avait quatre filles modèles de grâces et de vertus. Eh bien! Quel a été le résultat de leur mariage? La première, et ce fut la plus heureuse, épousa le Duc de Modène, a associé son nom à celui d'un prince universellement détesté. V. M. ne consentirait certes pas à un pareil mariage pour sa fille. La seconde de ses tantes a épousé le Duc de Lucques. Je n'ai pas besoin de rappeler les résultats de ce mariage. La Duchesse de Lucques fut et est aussi malheureuse qu'on peut l'être dans ce monde. La troisième fille de Victor-Emmanuel monta, il est vrai, sur le trône des Césars; mais ce fut pour s'unir à un mari impotent et imbécile, qui dut en descendre ignominieusement au bout de peu d'années. La quatrième enfin, la charmante et parfaite princesse Christine, épousa le Roi de Naples. V. M. connaît certainement les traitements grossiers auxquels elle fut exposée et les chagrins qui la conduisirent au tombeau avec la réputation d'une sainte et d'une martyre. Sous le régne du père de V. M. une autre princesse de Savoie a été mariée: c'est la cousine de V. M., la princesse Philiberte. Est-elle plus heureuse que les autres, et est-ce que V. M. voudrait que sa fille eût un même sort?
Les exemples que je viens de mettre sous les yeux de V. M. prouvent que, en consentant au mariage de sa fille avec le prince Napoléon, il y a bien plus de chances de la rendre heureuse, que si, comme son oncle ou son père, il la mariait à un prince de la maison de Lorraine ou de la maison de Bourbon.
Mais que V. M. me permette une dernière réflexion. Si V. M. ne consent pas au mariage de sa fille avec le prince Napoléon, avec qui veut-Elle la marier? L'Almanach de Gotha est là pour prouver qu'il n'y a pas de princes qui lui conviennent; et c'est tout naturel. La différence de religion s'oppose aux alliances avec les familles de la plupart des Souverains qui régnent sur des pays à institutions analogues aux nôtres. Notre lutte avec l'Autriche, nos sympathies pour la France rendent impossibles celles avec des membres de familles tenant aux maisons de Lorraine et de Bourbon. Ces exclusions réduisent le choix de V. M. au Portugal et à quelques petites principautés allemandes plus ou moins médiatisées.
Si V. M. daigne méditer sur les considérations que je viens d'avoir l'honneur de lui soumettre, j'ose me flatter qu'Elle reconnaîtra qu'Elle peut comme Père consentir au mariage, que l'intérêt suprême de l'État; l'avenir de sa famille, du Piémont, de l'Italie toute entière lui conseillent de contracter.
Je supplie V. M. de me pardonner ma franchise et la longueur de mes récits. Je n'ai pas su, dans une question si grave, être plus réservé, ni plus bref. Les sentiments qui m'inspirent, les mobiles qui me font agir, sont une excuse que V. M. voudra bien agréer.
Ayant dû écrire cette éternelle épître sur le coin de la table d'un auberge, sans avoir eu le temps de la copier, ni même de la relire, je prie V. M. de vouloir bien la juger avec indulgence et excuser ce qu'il peut y avoir de désordre dans les idées et d'incorrect dans le style. Malgré ces défauts que je viens de signaler, cette lettre contenant l'expression fidèle et exacte des communications que m'a faites l'Empereur, j'ose prier V. M. de vouloir bien la conserver afin de pouvoir à mon retour à Turin en extraire des notes qui pourront servir à la suite des négociations qui vont avoir lieu.
Dans l'espoir de pouvoir à la fin de la semaine prochaine déposer aux pieds de V. M. l'hommage de mon profond et respectueux dévouement, j'ai l'honneur d'être de V. M. Sire, le très humble et très obéissant serviteur et sujet
Signé: C. Cavour

- Nomi citati:
- Vittorio Emanuele II di Savoia, Sardaigne, Sire, Empereur, Tosi.
- Toponimi citati:
- Baden, Plombières, Berne, France, Autriche, Europe, Sardaigne, Angleterre, Paris, Massa, Carrara, Turin, Sardaigne, Italie, Parme, Modene, Romagne, Plaisance, Rome, Bologne.