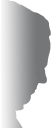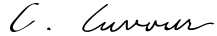28 gennaio 1834 - 28 gennaio 1834
- Diario:
- 1833-1834.
Ç’a a été un jour malencontreux pour moi. J’ai fait force gaucheries qui m’ont attiré bien des désagrémens. J’ai dîné chez Mr de Barante; il était sérieux et de mauvaise, ainsi il m’a été impossible d’en rien tirer, ni sur la politique ni sur autre chose. Enfin, après dîné il est descendu, me laissant dans le salon avec Mme de Barante et Montessuy. Je ne sais comment, je me suis animé sur le chapitre des devoirs conjugaux, et pendant longtemps je n’ai fait autre chose que violer les lois de la convenance et, ce qui est pis encore, celles de la grammaire. J’en ai retiré cependant deux fort jolies histoires que je consignerai quelque part sur mon journal, ne pouvant le faire dans cet endroit. En sortant de chez Mme de B[arante], j’ai été ailleurs; là, ç’a été bien pis. Je ne sais par quelle fatalité tout ce que je disais était une gaucherie, tantôt par rapport au malade, tantôt par rapport à la bien portante. J’ai si bien fait que mon hôte a pris de l’humeur et de la véritable humeur, qu’il n’a pu s’empêcher de me témoigner d’une manière assez déplaisante. Eh bien! je n’ai pas plus trouvé de l’esprit pour combattre et retorquer ses demi-impertinences que j’en avais eu quelques minutes auparavant pour le mettre sur ce train-là. Enfin, j’ai abandonné le champ de bataille, et me suis retiré chez moi, plus ennuyé, plus dégoûté de la vie que jamais, n’ayant pour me consoler que les souvenirs d’un passé vide d’intérêt, et d’un avenir sans but, sans espoir, je dirais presque, sans désir.
Il me restait encore une illusion: celle de l’amitié ou, pour être plus exact, celle de l’empire et du dévouement que la supériorité de mon esprit pouvait exercer sur mes amis. Eh bien, elle est passée, complètement passée, plus que toutes les autres illusions de vanité et de gloriole qui m’ont si longtemps dominé. D’amis de cœur, de ceux chez qui je croyais à la puissance d’affection pour moi, je n’en ai plus qu’un; et encore, comme elle est diminuée cette affection, ce dévouement, cette généreuse sympathie. Cette amitié si grande, si forte, dégénère tous les jours; pour peu que cela continue elle se trouvera rapetissée au niveau de toutes ces amitiés du monde qui consistent en des égards plus ou moins aimables, revêtues de belles phrases à l’usage de tout le monde. Ce n’est pas mon ami que j’accuse. S’il y a de la faute dans tout cela, elle doit m’être imputée: mon cœur cautérisé, glacé, inanimé ne pouvait pas satisfaire cette âme brûlante, pleine de sentiments méridionaux; notre amitié ne reposait donc plus depuis longtemps que sur le respect, la sympathie et mieux que cela encore que lui inspiraient certaines facultés supérieures qu’il croyait voir en moi. Ce n’était plus moi qu’il aimait, c’était ma puissante organisation intellectuelle. Mais pour que des facultés intellectuelles conservent l’admiration de ceux qui les observent, il faut qu’elles se développent, qu’elles s’exercent, en un mot, qu’elles remplissent la destinée assignée aux intelligences supérieures. L’ai je fait? Au contraire, tous les jours, mon esprit s’est restreint dans un cercle plus étroit; le germe de mes facultés (car à être vrai, s’il y a jamais eu rien en moi, ce n’a jamais été que des germes) loin de se développer, de produire ce qu’il promettait, n’a donné que les résultats les plus ordinaires et les plus communs. Un homme de salons, passablement spirituel. Cette misérable qualité seule reste des plus brillantes espérances; était-elle suffisante pour maintenir mon ami dans son admiration illusive [sic] pour moi? Impossible, le charme a été rompu. Je crois que le pauvre diable est maintenant tout honteux des sentimens qu’il m’avait jadis témoignés. Si dans nos conversations, je laisse apercevoir quelque reste de mes anciennes illusions, il l’écrase de suite sans pitié, le conspue, le ridiculise; seulement pour adoucir le coup qui serait trop fort pour ma vanité, encore si morbide, il ne me frappe [pas] directement, mais de concert avec la société et surtout cette société que nous nous étions créée dans nos jours d’avenir. Au fond, ma société l’ennuie. Nous passons notre temps à dire des choses communes, sans intérêt, ou à déplorer notre sort, à nous apitoyer sur nous-mêmes, à médire de l’ordre social, à maudire notre position particulière et cent autres choses aussi misérables.
En vérité, quand je résume ma position actuelle, je ne peux pas m’empêcher de convenir avec moi-même que je suis faussement et douloureusement placé, pour moi, comme pour les autres. Dans mes rapports de famille je n’ai plus d’agrémens. Amoureux d’indépendance avant tout, je suis le plus dépendant des hommes; fils de famille dans toute la force du terme, doué d’une volonté ardente, tracassière, je n’ai aucun sujet à l’exercer; mon domestique même, cet imbécile de Tomalin, a des moyens de s’y soustraire et il en use largement. Quant aux affections de famille, mes tantes s’est [sic] tout au plus si elles peuvent s’empêcher de me vouloir du mal. Elles n’ont pas tort; à leur place je crois que je détesterais un neveu qui me serait aussi décidément hostile que je le suis envers elles. Mon frère ne pense plus qu’à son fils; notre ancienne liaison, l’admiration des badaux [sic], ne portant que sur une complète sympathie de raison, n’existe plus maintenant que nous différons si complètement dans notre manière de voir sur le point capital de sa vie: l’éducation de son fils. Nous ne nous aimons plus. C’est tout au plus si nous nous adressons quelque fois la parole sur des sujets indifférents. Ma mère m’aime encore, je crois même qu’elle m’aime encore beaucoup; elle est si bonne, ma mère, si tendre, qu’elle a même de l’amour pour moi qui ne le mérite guère; mais au fond, je ne suis pas nécessaire à son bonheur, elle a trouvé dans les petits enfants d’autres objets d’affection et de tendresse plus adaptés à son genre de sensibilité, et qui lui suffisent pour l’absorber complètement. Quant à moi, avec mon humeur chagrine, je suis plutôt un obstacle qu’un moyen pour son bonheur. Papa est bien bon; mais sa bonté est d’un genre un peu matériel; je suis peu propre à seconder ses vues, au contraire, je les entrave continuellement. Il me le pardonne, mais si je venais à lui manquer, il reporterait aisément toute son affection sur ses petits enfants et il aurait encore bien des années à se bercer d’illusions sur leur sort futur. Je ne parle [pas] de mes amis. Beaucoup de personnes ont de l’estime, de la bienveillance pour moi; en général tous ceux qui me connaissent me veulent du bien, mais je ne suis nécessaire à aucun, tout au plus suis-je utile à un ou deux, et encore de quelle mince utilité. Je pourrais donc les quitter sans remords. Ainsi donc aucun lien bien fort ne m’attache plus à la vie et j’ai pour en être dégoûté de nombreuses causes. L’avenir, loin de me sourire, ne m’offre qu’une aggravation progressive et continuelle d’ennuis. Que serais-je à trente ans? Fils de famille comme à cette heure, j’aime mille fois penser que je n’y serai plus.
Ah, si ce n’était des doutes qui me restent sur la moralité du suicide, en vérité je me délivrerais bientôt de cette fastidieuse existence. Mais même benthamiquement raisonnant, je ne peux les résoudre. Quant aux effets de premier ordre, je crois bien qu’en mon cas particulier ils présentent une balance favorable au suicide. Mais les maux de second ordre? Comment les apprécier dans ce cas? Cette action, sous un point de vue général, est blâmable; tout ce qui y pousse est donc un mal, excusable seulement quand il est compensé par d’immenses avantages. Pour le moment donc, je ferai comme Hamlet, je ne me tuerai pas, mais pour le moins, j’adresserai d’ardentes prières au ciel pour qu’il m’envoie une bonne fluxion de poitrine, qui m’emporte dans l’autre monde. De cette manière là, ma conscience serait tranquille, l’amour de l’existence ne serait ébranlé chez personne. Au contraire, ma mort, qu’on appellerait une catastrophe funeste, produirait un excellent effet sur bien des gens; l’effet moral serait utile au lieu d’être nuisible. Mes parens, qe je tranquillisareais par des simagrées religieuses, me pleureraient un mois durant, quelques jors de plus qu’ils ne l’ont fait pour cette pauvre Adèle, et puis l’on m’oublierait. Ou bien se rappellerait-on de moi quelquesfois pour faire une leçon à mes neveux sur les dangers d’un développement trop précoce de l’intelligence, l’amour excessif de l’indépendance et l’excès de vanité. Oh! si je savais un remède qui donnât une fluxion de poitrine!!

- Nomi citati:
- Mr de Barante, Mme de Barante, Tomalin, Montessuy, Papa, ma mère, pauvre Adèle, Mon frère, neveu, son fils, Hamlet.